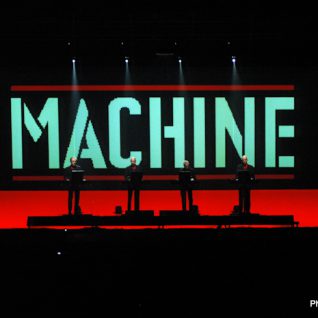Mathieu David Gagnon : “Pink Floyd, Tangerine Dream et Bach, ça donne Flore Laurentienne”
Flore Laurentienne est un projet de musique orchestrale instrumentale inspiré par l’observation de la nature et retranscrit à travers le prisme sensible de son compositeur, Mathieu David Gagnon. Quelques jours avant ses deux concerts aux Trans Musicales, nous avons échangé avec cet artiste québécois qui parvient à concilier une certaine ambition artistique avec une approche intuitive et décontractée. Pris tôt le matin au saut du lit – décalage horaire oblige – le compositeur débute très tranquillement, en énonçant chaque mot de façon déliée, puis s’anime au fil de l’entretien, alternant digressions essentielles et envolées poétiques, lorsqu’il parle de sa source d’inspiration, le fleuve Saint-Laurent.

Pouvez-vous nous parler de votre itinéraire musical qui vous a amené à créer votre projet Flore Laurentienne, pour lequel vous êtes invité aux Trans Musicales ?
Mathieu David Gagnon : « Je viens d’un milieu musical plutôt pop et rock. Mais je me suis intéressé, au début de l’âge adulte, à l’écriture musicale, du point de vue de l’orchestration, de l’arrangement, et surtout du contrepoint, de la technique d’écriture. J’ai une formation en écriture classique que j’ai suivie à Montréal, et aussi en France, au Conservatoire de Bordeaux. J’ai également un grand intérêt pour les synthétiseurs et les vieux claviers qui étaient utilisés à l’époque du rock progressif, au début des années 1970. J’ai donc plusieurs chapeaux, entre mes premiers amours rock progressif et l’étude de la musique classique. Je pense que ça décrit bien les deux principales influences de mon projet musical. Il y a toutes ces textures, ces sons qui viennent des bands comme Genesis ou Pink Floyd et des débuts de l’électronique, Tangerine Dream, Kraftwerk, Brian Eno. J’aime la texture de son de ces vieux synthés. Si on prend ces influences-là, puis qu’on les mixe avec Jean-Sébastien Bach et un petit peu de Brahms et de Schumann, ça donne pas mal de Flore Laurentienne. [rires] »
C’est intéressant que vous associiez musiques classiques et progressives parce que le rock progressif est lui-même issu du rapprochement entre rock psychédélique et orchestrations classiques dans la deuxième moitié des années 1960, avec des groupes comme The Moody Blues ou The Nice, avec Keith Emerson.
« Oui, les artistes se sont alors réappropriés certains éléments de la musique classique comme l’orchestration. Ça a été possible grâce à l’arrivée des nouveaux instruments, comme le mellotron par exemple [l’ancêtre du sampler : un instrument à clavier dont chaque touche déclenche la lecture d’une bande magnétique sur laquelle est enregistrée une séquence sonore]. Ça permettait à ces artistes rock, qui avaient ce background un petit peu plus classique mais qui n’avaient pas les moyens d’enregistrer un gros orchestre dans leurs disques. Si je pense à un album de Yes qui s’appelle Fragile, je crois qu’on y entend le troisième mouvement d’une symphonie de Brahms, repris par Rick Whiteman au clavier.
On a aussi ce même genre de reprises faites par Emerson, Lake & Palmer, avec des éléments de musique classique qui sont joués dans un autre contexte. Je pense que c’est aussi tous ces disques qui m’ont beaucoup influencé, qui m’ont inspiré pour essayer de devenir un peu plus savant sur les techniques d’écriture, d’orchestration, d’harmonie, parce que je n’avais pas envie d’être un musicien classique. Je n’ai pas ça dans le sang. Je n’ai pas ce dévouement-là, mais j’aime vraiment la musique classique. Pas tout, mais j’aime profondément certains compositeurs. Pour être clair, je ne trippe pas sur… disons, sur l’opéra. Je trippe plus sur les pièces de piano de Brahms, par exemple. C’est pour ça que je prends ce que j’aime dans la musique classique, et puis je prends ce que j’aime dans le rock progressif, dans la musique pop, dans la musique électronique et dans la musique expérimentale. Je prends ce que j’aime et je mets tout ça ensemble. »
Quand on écoute votre musique, on pense aussi aux compositeurs américains de musique “minimaliste” du 20e siècle.
« Oui, c’est ça. D’ailleurs Philip Glass, au début de sa carrière, est aussi passé par une instrumentation nouvelle, entre guillemets. Sur ses premières pièces de 1968–69-70, jusqu’à l’opéra Einstein on the Beach en 1976, il a souvent utilisé des orgues électroniques Farfisa. Là encore, c’est l’instrument qui est le véhicule de nouveautés dans le style musical. L’utilisation de nouveaux instruments a souvent inspiré certaines pièces et même certains courants musicaux, comme la boîte à rythmes TR-808 pour le hip hop. Ou les orgues à transistors pour la musique minimaliste, il me semble – au moins chez Philip Glass. Steve Reich en a aussi utilisé. »
Oui, tout cela confirme que les timbres des instruments aussi font la musique, pas seulement les rythmes et les mélodies, comme nous le disait récemment Raül Refree.
« Absolument. »
Pour revenir sur votre manière de décrire votre musique comme une rencontre entre deux passions, la musique classique et le rock progressif, vous dites parfois aussi que vous ne vous reconnaissez pas forcément dans le courant “post-classique” ou “néo-classique” auquel sont associés par exemple Nils Frahm ou Max Richter. Pouvez-vous nous dire pourquoi ?
« Pour être franc, je ne connais pas bien. Je n’avais même jamais écouté jusqu’à ce que je lance mon projet et encore aujourd’hui, ce n’est pas quelque chose que j’écoute. Je pense que je suis beaucoup plus influencé par certains disques de Brian Eno, notamment Discreet Music [sorti en 1975] qui est un disque vraiment très intéressant parce qu’on y entend un orchestre à cordes qui reprend une version réécrite du Canon de Pachelbel [composé vers 1680 par Johann Pachelbel]. Plus les notes sont basses, plus elles sont longues. Ça a été réécrit selon un certain ratio mathématique. Dans la première mesure, on reconnaît l’œuvre originale, et plus ça avance, moins on la reconnaît.
Je pense que ma musique est beaucoup plus influencée par des concepts de compositeurs, c’est-à-dire des concepts de géométrie, de formules mathématiques… Elle est plus pensée dans un esprit de compositeur que d’interprète. Et elle est beaucoup plus influencée, justement, par ceux qu’on a appelé “minimalistes” – je dis ça parce qu’il faut essayer de jouer Einstein on the Beach… jouez-le, puis dites-moi sans rire que c’est du minimalisme… C’est aussi de la musique de concept, c’est-à-dire que la façon d’écrire est un concept. La composition suit des patterns mathématiques [des motifs qui se répètent], mais dans un esprit artistique. Cette technique d’écriture-là m’a ouvert les yeux sur de nouvelles façons de composer, pour pouvoir aussi apporter l’improvisation dans la musique en live. C’est-à-dire que les pièces sur l’album sont figées mais que j’aime trouver de nouvelles façons d’écrire les choses qui permettent d’ouvrir les pièces dans un contexte live. C’est ce que je fais avec Flore Laurentienne, le groupe. »
Et sur scène justement, cela prend quelle forme ?
« On tourne toujours avec un quatuor à cordes. Ça, c’est la base. Et en plus il y a moi, accompagné de deux instrumentistes. Et comme ce qui me drive dans mon approche artistique, c’est de me donner des défis, alors sur les albums, il n’y a pas de percussions, mais par contre, en concert, je tourne avec deux percussionnistes. Et la seule règle, c’est “ne jouez pas de beats”. Pas de rythme, pas de séquence rythmique qui se répète. Donc ces deux percussionnistes jouent des claviers en plus des percussions, et c’est un peu comme s’ils tenaient les rôles d’un bassiste et d’un batteur. Ces rôles sont respectés pour la cohésion du projet et de la direction musicale. Parce que c’est important d’avoir un batteur dans un groupe live. En studio, c’est plus facile, on se met un petit clic [un métronome], mais en live, on joue sans séquence pour que, justement, il y ait de la vie, pour qu’on puisse improviser… »
On devine à travers tout cela une forte envie de liberté.
« À ce propos, j’ai vécu en France, j’ai étudié en France trois ans au Conservatoire. J’ai découvert la grande séparation qu’il y a en France entre la musique classique et les musiques, disons, populaires ou comme vous dites – vous avez un très beau terme un peu condescendant – “de variétés” ! Quand j’y étais, on me parlait beaucoup de musique classique et de variétés. C’était soit l’une, soit l’autre. Les deux milieux ne se parlaient pas, c’était impossible. Je suis revenu ici avec ça. Je pense que de par mon côté nord-américain, j’ai moins ces catégories-là ancrées en moi. Je n’ai aucun scrupule à mélanger les choses. Et puis j’adore ça. J’adore le fait que je peux écrire une fugue, sans avoir l’air d’être quelqu’un qui écrit une fugue quand je rentre sur le stage [la scène]. J’aime ça, mélanger les genres, qu’il n’y ait pas de frontières, et puis qu’il n’y ait pas de jugement non plus entre les deux univers. Je pense que c’est ça… c’est une histoire de jugement. C’est très important pour moi d’être libre dans toute la musique que je veux aborder, et puis de ne pas classer ça dans des cases. »
Étant donné que votre projet Flore Laurentienne est basé sur l’évocation du fleuve Saint-Laurent et de la nature qui l’entoure, on a aussi envie d’en savoir plus sur le rapport que vous avez, vous et votre musique, à cette nature. D’où êtes-vous originaire au Québec, d’une grande ville ou plutôt d’un endroit isolé ?
« Je suis de la Gaspésie. C’est une région pas très populeuse du Québec, mais plus que le Nord quand même. Si on regarde la carte du Québec, il y a comme une patte de chat avec une petite griffe qui sort du gros triangle, qui s’enfonce dans l’océan Atlantique. Ça, c’est la Gaspésie. Moi, je viens d’une ville moyenne, petite à moyenne, qui s’appelle Sainte-Anne-des-Monts, sur la côte nord de la petite patte de chat. Donc ça fait face au fleuve Saint-Laurent. À cette hauteur- là, il est très large. Peut-être quelque chose comme 80 kilomètres de large.

© A.-Léo Leymarie (1876–1945)
Donc, c’est là que le fleuve arrive, c’est l’embouchure qui devient plus loin l’océan. Je sais qu’en France et en Europe il y a des fleuves, mais le fleuve Saint-Laurent… tu as une impression quasiment d’océan à cette hauteur-là. C’est vraiment une présence. C’est un petit peu comme être devant la mer. J’ai grandi là. Je pense que pour tous les gens qui grandissent près du fleuve, c’est quelque chose de marquant dans leur vie quotidienne. C’est une force. Il y a des gros courants, c’est très tumultueux, mais ça peut être aussi très tranquille. C’est vraiment un personnage qui nous accompagne au quotidien. Et puis je dois aussi préciser que Flore Laurentienne, c’est d’abord le titre d’un livre sur la botanique. J’ai utilisé ce nom-là pour faire référence à la nature québécoise. On est un peuple assez jeune, et jusque dans les années 1930, il n’y avait pas vraiment de livre qui nous parlait de la nature qui nous entourait. Flore laurentienne, cette encyclopédie-là, a été le premier livre à recenser toutes les espèces de plantes qui étaient indigènes à notre région. Moi, je vois ça un peu comme la première fois où on met des mots sur notre culture. C’est un livre qui est encore utilisé aujourd’hui, qui est encore très, très actuel. Et pour moi, ça fait aussi référence à mon grand-père qui était agronome, donc qui a utilisé ce livre-là. L’autre chose, c’est que je voulais me placer dans l’industrie de la musique d’une certaine manière, que ma musique soit plus mise en avant que moi. Parce qu’on sait très bien que si tu veux avoir une carrière musicale, il faut faire des entrevues, prendre des photos, mettre sa face sur la pochette de l’album… Mais moi, je n’avais pas envie de faire ça. Donc, c’était aussi une manière pour moi de me cacher derrière la nature et que la musique soit mise en avant. Parce qu’une des premières phrases du livre, c’est “Le livre répertorie toutes les plantes indigènes de cette région-là du Québec avant la présence de l’Homme”. Donc, je voulais que la présence de l’Homme soit réduite au minimum dans le projet. Comme s’il n’y avait pas de compositeur derrière, que ce soit juste de la musique. Comme quand on marche dans une forêt, qu’il n’y a pas d’intervention de l’Homme, qu’on constate juste que les choses sont belles, qu’elles sont simplement là, et qu’il faut juste les regarder. Donc, au début, c’était ça le choix du nom, le choix de l’esthétique. Mais finalement, je me rends compte que je me fais quand même prendre en photo et je fais des entrevues [rires]. Mais je le fais à ma manière. »
Parlons de vos secrets de fabrication : comment est-ce qu’on fait en tant que compositeur pour évoquer la nature ? Car dans votre musique, il n’y a pas d’enregistrement des sons du fleuve, de la nature ou du vent. Est-ce qu’il y a des méthodes ou des techniques pour évoquer ça quand on compose ? Ce n’est pas juste une inspiration divine, il doit y avoir un travail spécifique ?
« Je dirais que le principal, c’est d’être assis devant le fleuve, là où je vis, et de regarder. J’habite dans une chaîne de montagnes qui s’appelle les Appalaches et j’ai une vue sur le fleuve. Donc, je le vois tous les jours, dans sa flamboyance, dans ses temps gris, dans ses couleurs rosées de fin de journée. L’été, ce n’est pas la même chose que l’hiver, les couchers de soleil, les levés de soleil et les couleurs sont… Je te dirais qu’il faut juste cultiver sa sensibilité à ça, mais c’est principalement de l’observation. Ça va m’évoquer des textures, pas de notes ni de mélodies. Je dirais que c’est ça qui est le plus étrange, parce que l’important n’est pas d’entendre une mélodie, c’est plus de sentir, d’avoir l’espace dans sa tête pour récolter toutes ces images-là. Et puis un jour, tout sort d’un coup. Mais il n’y a pas de secret, il n’y a pas de recette. C’est une évocation. Je pense que c’est ça la beauté de la musique, de l’art musical. C’est de pouvoir évoquer des choses sans mots. C’est précieux. C’est un peu comme tu l’as exprimé… un peu… divinatoire [rires]. Je ne parle pas de mon inspiration, je parle du fait que notre cerveau est capable d’associer des textures, des sons, à des couleurs ou à des paysages… L’évocation est ultra puissante. Donc, il n’y a pas vraiment de réponse précise à ça. Chaque pièce est différente, chaque pièce qui porte sur le fleuve. C’est-à-dire que je ne m’assois pas devant le fleuve en me disant “aujourd’hui, j’écris une pièce sur le fleuve.” Non, ça arrive. J’ai des images dans ma tête. Je ne suis pas obligé d’être assis devant. Je peux être dans une chambre d’hôtel à Shawinigan, puis j’ai un flash, et ces images-là sont imprimées à l’intérieur de moi. Il n’y a pas de réponse précise… mais c’est une bonne question ! [rires] »
Pour finir, à propos de votre venue aux Trans Musicales puisque vous allez y jouer deux fois : le samedi après-midi, dans l’auditorium des Champs Libres, dans le cadre d’une conférence-concert où l’on va justement parler de l’évocation de la nature dans la musique instrumentale, et aussi en pleine nuit, dans le Hall 3 du Parc Expo, avec une ambiance forcément beaucoup plus chaude. Avez-vous une appréhension ou une réaction par rapport à ça ?
« Ça, j’en fais mon affaire. C’est-à-dire que ça fait partie de la game [du jeu]. Je pense qu’on n’a pas d’autre choix que d’adapter notre concert avec le lieu où on joue. On a joué ici, au Québec, dans une quinzaine d’églises. Ce n’est pas le même show que dans une salle très intime ou en extérieur au Festival de jazz de Montréal devant 13 000 personnes. Je pense que c’est aussi pour cette raison-là qu’on adapte à chaque fois nos pièces. Et puis comme je le disais tout à l’heure, les pièces ne sont pas fixées dans une forme. C’est justement aussi pour que je puisse les adapter dans différents contextes. Je pense que c’est ça aussi que j’aime, le défi qu’on se lance dans ces moments-là. Il y a des pièces que je vais couper courtes si je vois que ce n’est pas le bon contexte, ou même que je ne les jouerai pas. Ou alors je vais improviser une transition qui va être plus en phase avec le public que j’ai devant de moi. Ça fait partie du métier, c’est quelque chose qui doit être fait. On oublie souvent que dans la musique classique, avant, il y avait de l’improvisation, parce que c’était la musique de tous les jours, c’était la musique “normale”, donc associée à plein de contextes. J’imagine qu’ils ne jouaient pas de la même façon dans un bal populaire, dans une salle de concert ou à la cour du Roi, ils s’adaptaient… et en plus, ils ne répétaient pas ! Ils y allaient juste au feeling. Ça s’est ensuite complètement perdu dans la musique classique, puisqu’elle est arrivée à un point où il faut que toutes les interprétations soient relativement semblables, peu importe le lieu et le contexte. Mais peut-être que c’est la différence entre de la musique vivante et de la musique… un peu moins vivante ? [rires] »
Flore Laurentienne sera en concerts aux 45es Trans Musicales, au Hall 8 du Parc Expo le jeudi 7 décembre, ainsi qu’à l’auditorium des Champs Libres, le samedi 9 décembre, dans le cadre d’une conférence-concert ayant pour thème Récit et nature dans les musiques instrumentales.